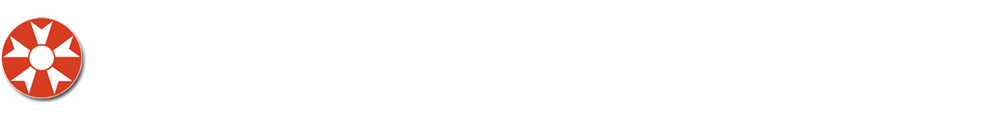Le chef d’escadron Brosse, commandant le groupe de 90, à Mme Leroy-Beaulieu, le 28 janvier 1915
Il est vrai que le capitaine Leroy-Beaulieu a disparu au cours du combat du 13 janvier. Les Allemands, ayant enfoncé la première ligne de tranchées, ont surpris les batteries que l’infanterie ne couvrait plus. Par suite de la position, elles étaient impuissantes à se défendre seules, et l’ordre d’évacuation fut donné. Le capitaine Leroy-Beaulieu donna lui-même les ordres d’exécution et présida à la mise hors d’usage des canons. Il fit descendre ses hommes en disant à l’adjudant qu’il passait à son domicile pour prendre ses chevaux et qu’il rejoindrait le détachement. On ne l’a plus revu. Je ne crois pas qu’il ait pu prendre une détermination tragique. Ses hommes n’ont pas fui ; ils sont partis parce que l’ordre a été donné de battre en retraite en enlevant les culasses. C’était d’ailleurs une éventualité prévue d’avance, même dans des ordres imprimés, et dont nous nous étions souvent entretenus car notre situation était de plus en plus périlleuse. Jamais il n’a manifesté à ce sujet la moindre révolte. Il critiquait les dispositions prises et s’élevait avec sa vivacité ordinaire contre une situation qui avait de grandes chances d’amener les conséquences qu’elle a eues en effet, mais il ne semblait pas disposé à assumer personnellement la moindre responsabilité à ce sujet. Dans ce malheureux combat du 13 janvier, tout le monde a fait son devoir. Au commandant ressort la responsabilité de ce qui s’est passé, ses intentions l’ayant conduit à faire occuper le terrain dans des conditions où le repli de l’artillerie était à peu près impossible.
Je suis convaincu que le capitaine Leroy-Beaulieu a été blessé au moment où il suivait ses hommes et qu’il n’a pu suivre leur mouvement. Le malheur est qu’ayant fait connaître son intention de faire un détour, son absence n’a été remarquée que beaucoup plus tard.
Je me trouvais à Bucy, où était mon poste de commandement ; le personnel de la batterie est arrivé en bon ordre, conduit par l’adjudant Walter, qui a rendu compte des instructions données par le capitaine. À ce moment, il ne restait pas un fantassin à Bucy et l’on venait de signaler la présence d’Allemands dans la plaine, en vue des premières maisons. J’ai donné l’ordre à la colonne de se mettre en route, comptant que le capitaine Leroy-Beaulieu passerait au poste de commandement. Je suis encore resté une heure à Bucy ; les Allemands, craignant sans doute une embuscade, étaient remontés au-dessus du Montcel. N’ayant pas vu le capitaine et sachant qu’il partait à cheval, j’ai pensé qu’il avait rejoint. Ce n’est que dans la soirée, lorsque, m’étant mis à la recherche des éléments épars, je pus me rendre compte qu’il n’avait été vu par personne, et je commençais à être inquiet. Nous retournâmes à Bucy à 11 heures du soir et j’envoyai une reconnaissance au domicile du capitaine au Montcel. Là, on trouva son ordonnance, le nommé Salmon, qui tenait les chevaux sellés et prêts à partir. Il n’avait pas vu le capitaine depuis le matin et refusait de quitter le cantonnement, ne voulant pas partir sans son capitaine. Le village du Montcel était inoccupé, mais des pentes du ravin partait une fusillade intense. Il était impossible d’aller jusqu’à l’emplacement de la batterie occupée par les Allemands, et il fallut revenir… De toutes les conséquences qu’entraînaient cette malheureuse affaire du 13 janvier, la disparition du capitaine Leroy-Beaulieu a été pour moi la plus cruelle…
Le 14 au matin, après avoir demandé partout si l’on n’avait vu le capitaine Leroy-Beaulieu, il ne m’est plus resté d’espoir de le retrouver…
Veuillez agréer, Madame…
Récit fait par les infirmiers Bouttier, Lucien Serta et le sergent Marquis, du 152e régiment d’infanterie, section hors rang (en réalité, 352e régiment formé à la mobilisation, issu du 152)
Nous étions prisonniers depuis environ une demi-heure le 13 janvier 1915, nous étions les infirmiers du poste de secours du Montcel, c’était celui de la batterie du capitaine Leroy-Beaulieu. Vers 1 heure, un officier allemand est venu nous trouver : « Si vous voulez sauver un officier français, venez. C’est un brave, il a bien fait son devoir ; il faut aller le chercher, venez avec moi. »
Nous sommes partis, mais Palméro fut blessé à l’épaule. Le feu français était intense ; nous sommes rentrés dans la grotte.
Un quart d’heure après, l’officier allemand est revenu : « Le feu est moins fort, je vous ai dit qu’il faut aller chercher l’officier. » On y est allé. On l’a trouvé derrière une pièce, assis sur le banc de sa batterie, devant l’arbre qui était déchiqueté (ce n’était pas la pièce isolée, mais la batterie). Il était gardé par deux sentinelles allemandes baïonnette au canon. Il avait refusé de les suivre. Il avait un gros caillot sur l’œil droit et beaucoup de sang sur ses vêtements. Il avait sa connaissance.
Quand je suis arrivé, je lui ai dit : « Mon capitaine, voulez-vous venir ? — Qui êtes-vous ? — Français ! — Mais qui êtes-vous ? — Nous sommes les brancardiers du 52e de ligne. Nous venons vous chercher. Venez avec nous, ça bombarde. — Non, laissez-moi, je veux rester à côté de ma pièce »…
Je lui ai fait comprendre que nous étions prisonniers, qu’il n’y avait plus rien à faire. Alors, il a bien voulu. Je l’ai mis sur un brancard. Je l’ai descendu à la grotte, il avait un énorme caillot de sang à l’œil. Bouttier lui avait mis de la teinture d’iode.
« Vous ne l’avez pas lavé ? — Non, ça nous a été défendu parce qu’on n’avait pas les mains propres. — Il a dû beaucoup souffrir quand vous lui avez mis de la teinture d’iode dans l’œil. — Non, c’était sur le caillot. »
Nous avions déjà quelques blessés, on l’a couché sur la paille…
Il avait des moments de délire. Il criait d’une voix brève : « Adjudant Lecocq, venez à moi », ou bien : « Je te dis de finir, et puis viens à table. » Il devait parler à sa fille.
On lui demandait : « Vous êtes bien, mon capitaine ? — Oui, je suis très bien, très bien. » Tout ce qu’il réclamait, c’était une piqûre contre le tétanos.
Vers le soir, des officiers allemands sont venus le féliciter ; il a parlé français et allemand ; c’était presque un défilé. Il en est venu toute la nuit pour lui faire des compliments. On l’a dérangé au moins dix fois. Un officier supérieur, colonel ou général, je ne sais, a voulu lui prendre la main. Il a refusé en parlant allemand ; il a dit : « Je ne donne pas la main à un ennemi. » À la fin, ça l’a énervé. Il a dit : « Et puis, j’en ai assez, fichez-moi la paix. » L’officier a demandé ce qu’il disait, mais on était ennuyé, on n’a pas osé lui répéter. On lui a dit : « Il a le délire, il ne faut pas faire attention… »
Il est venu deux compagnies camper dans la grotte. Les officiers allemands n’ont pas voulu que nous le mettions avec nous. Ils ont dit : « Gardez les soldats, nous gardons les officiers. » Ils nous ont renvoyés dans notre gourbi et ils l’ont gardé.
Au milieu de la nuit, vers 10 heures, le feldwebel est venu nous réveiller : « Capitaine évadé. Pas trouvé. Vous fusillés si vous trouvez pas. » Bouttier, Marquis et moi sommes partis avec quatre Allemands baïonnette au canon, qui nous ont d’abord demandé si la grotte avait deux issues ; on leur a répondu : « Non », sans savoir rien. C’est là qu’ils nous ont dit : « On va explorer la grotte et chercher le capitaine, qu’on ne peut pas arriver à retrouver. » On a cherché avec les torches, mais ce n’est pas commode, dans toutes ces galeries. On appelait partout le capitaine. On n’était pas tranquille, et puis comme on revenait vers l’entrée sans l’avoir trouvé, on se demandait ce qu’ils allaient faire de nous. Mais on a vu deux Allemands qui le ramenaient. Il n’avait plus son manteau. Quand nous l’avons ramassé, il avait son grand manteau. Il l’avait quand je l’avais couché la première fois après son pansement.
C’est là, quand il a été ramené par les Allemands, que nous avons redemandé qu’on le remette avec nous. On a bien voulu. Nous l’avons recouché. Nous l’avons mis entre nous…
Les officiers allemands nous ont raconté qu’il tirait encore le canon quand ils étaient arrivés à le cerner — et qu’alors, voyant qu’il était prisonnier, il a sorti son révolver et il a tiré ; on lui a crié : « Rendez-vous », mais il a tiré deux Boches presque à bout portant, alors, voyant cela, un autre lui a tiré dessus.
Les officiers disaient qu’ils voulaient le faire prisonnier ; ils n’ont pas voulu le tuer. Ils voulaient le prendre vivant. S’il n’avait pas sorti son révolver, ils n’auraient pas tiré. Ils ont dit : mais quand il a eu abattu deux Boches, « on n’a pas pu empêcher les autres de tirer »… Les Allemands avaient fait un mouvement tournant et ils étaient arrivés si vite que nous avions cru que c’étaient les Français ; nous ne les avons pas vus. Notre régiment n’a pas eu le temps de se replier. J’avais vu deux artilleurs partir avec une culasse environ une demi-heure avant que nous soyons faits prisonniers et nous nous sommes dit : « Qu’est-ce qu’ils font ? » On ne savait pas que la 5e batterie était cernée.
Les Allemands, avant d’envahir les tranchées de première ligne de notre régiment, avaient fait un mouvement tournant.
Deux jours après, le pasteur de Nanteuil-la-Fosse m’a demandé : « Quelle est la distinction la plus honorifique qu’on donne aux officiers en France ? — De lieutenant et capitaine à colonel, c’est la Légion d’honneur. Pour les généraux, c’est la médaille militaire. » Le pasteur a répondu : « Il a mérité les deux. »
Témoignages du docteur Geissler, médecin-chef de l’ambulance allemande
Le 19 janvier 1915, le docteur Geissler, médecin-chef de l’ambulance allemande n° 3, IIIe corps d’armée, adresse à Mme Pierre Leroy-Beaulieu cette lettre (traduction) :
Anizy-le-Château, le 19 janvier 1915.
Très Honorée Madame,
C’est avec l’expression de la plus profonde condoléance que j’ai l’honneur de vous faire part que monsieur votre mari, capitaine d’un groupe de territoriale du 9e d’artillerie, est mort avant-hier, dans mon ambulance, des suites d’une grave blessure à la tête. Ainsi qu’il m’a été rapporté, il a été blessé en combattant avec la bravoure d’un héros.
Après tous ses servants, il a servi encore lui-même sa pièce. Quand il fut obligé de cesser, il continua à se défendre avec son révolver à la main jusqu’à ce qu’une balle, qui pénétra dans la tempe droite en endommageant l’œil, l’eût atteint.
Il a été blessé le 13 janvier. La blessure était si grave qu’il a perdu immédiatement connaissance et ne l’a plus retrouvée jusqu’à sa mort, qui a été sans souffrance et douce. L’enterrement a eu lieu aujourd’hui dans notre cimetière de militaires, avec les honneurs militaires en présence d’officiers et de soldats allemands.
Sa tombe a été ornée d’une croix et est reconnaissable par le n° 76. La bénédiction a été donnée par le prêtre catholique de la division de notre corps d’armée. Je m’incline profondément et plein d’admiration devant la vaillance de ce camarade combattant héroïquement, jusqu’à la dernière extrémité pour sa patrie.
Ce m’est en même temps une douleur que notre science médicale, qui, bien entendu, a tout fait pour lui venir en aide, n’ait pu réussir à conserver cette vie si précieuse pour les siens.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma plus haute considération. Que Dieu vous console, vous et vos enfants.
Docteur Geissler
Stabsarzt (« médecin-capitaine »)
et médecin-chef de l’ambulance n° 3, IIIe corps d’armée.
Mme Pierre Leroy-Beaulieu, en retour de cette lettre du médecin, le docteur Geissler, l’avait remercié et lui avait demandé quelques renseignements complémentaires concernant la mort de son mari. Sans attendre, il lui adressa un nouveau courrier circonstancié.
Madame,
Vos lignes du 17 février me sont parvenues. Ce m’est une joie de reconnaître dans votre lettre une très grande et vaillante femme.
D’après votre demande, je vous donne ci-après, autant que cela m’est possible et que je l’ai appris, les renseignements concernant les derniers événements de la vie de monsieur votre mari.
1° Votre mari décéda le 17 janvier, le matin à 8 heures et demie. Une sœur était à son chevet et lui ferma les yeux.
2° Comme je l’ai appris dans le discours de l’aumônier de la Ve division d’infanterie, M. l’abbé Hour, lorsque votre mari fut retrouvé et remis à une ambulance, il avait encore sa connaissance et il a prononcé quelques mots. Je n’ai appris cela que pendant l’inhumation quand la lettre que je vous adressais venait de partir. Je n’ai pu savoir ce qu’il a dit. Peut-être l’aumônier pourrait-il vous renseigner en s’adressant directement à lui, adresse (Ve division d’infanterie, IIIe armée).
3° L’endroit où il reçut sa blessure est le versant du Montcel. Mais on ne peut préciser quelle arme l’occasionna. On comprend très bien, en réfléchissant, avec quelle vitesse les événements se déroulent et comment aussi une partie des souvenirs s’évanouit tandis que d’autres s’élèvent à la fantaisie.
Près de la pièce, quelques soldats doivent être tombés ; on ne peut savoir si c’étaient des artilleurs ou d’autres soldats appartenant à d’autres troupes. Une pièce peut être très bien servie par un seul homme. Mais votre mari dut cesser le feu parce que les munitions manquaient. Je n’ai pu savoir si les servants furent faits prisonniers, ni comment ils s’appelaient ; cela vous sera possible après la guerre, sinon déjà à présent, par les communications ou rapports des troupes ayant pris part à l’action.
4° Votre mari s’est vaillamment défendu, mais on ne peut savoir s’il a tué ou blessé des adversaires. D’après toutes les probabilités, un combat d’arrière a eu lieu. La balle qui a blessé votre mari entra dans la tempe droite et ressortit par l’œil droit. Naturellement, la trépanation fut faite, car chacun de nos lazarets de campagne est, par le personnel et le matériel, installé de façon à pourvoir à tous les événements, même les plus considérables. Le jour de l’opération, le 14 janvier, au soir, nous avions même deux médecins-chirurgiens avec nous qui venaient du commandement général.
5° Le transport eut lieu à 1 heure de l’après-midi. Il fut d’abord amené à la place principale des pansements ; puis dans un autre lazaret de campagne et, de là, conduit chez moi, parce que j’étais pourvu de l’installation Röntgen nécessaire.
Avant l’opération, une radiographie de la tête fut prise. Vous voyez donc, Madame, que, de notre côté, tout ce qu’il a été possible de faire pour sauver ou venir en aide l’a été, quoique nous ayons eu, dès l’abord, l’impression que nous étions en face d’une blessure extraordinairement grave.
Je me permets de vous assurer que nos soldats se sont conduits avec la plus haute humanité envers les blessés, non seulement près de Soissons, mais je possède en grand nombre des certificats établissant qu’ailleurs, il en a été absolument de même. Nos soldats allemands, notre peuple allemand ne sont pas capables d’une telle barbarie comme celle qu’a montrée la populace de Reims envers nos braves soldats blessés. Je vous suis sincèrement reconnaissant de cette communication ; Dieu récompensera l’héroïque curé de son intervention.
Je connais la guerre depuis le commencement, et à ma profonde douleur, il m’a été donné de voir les horreurs dont le peuple belge s’est rendu coupable. Des camarades chers furent tués par la population civile. Des femmes s’oublièrent assez pour oser tirer de leurs maisons sur nos soldats. Les habitants de la France n’ont heureusement pas à se reprocher de pareils crimes. C’est pourquoi notre soldat partage avec eux ce qu’il peut économiser, il garde les enfants, joue avec eux. Moi-même, j’ai plusieurs fois fait distribuer à des enfants nécessiteux ce qui nous restait. Celui qui s’est consacré réellement au but élevé de la Croix-Rouge, tel qu’Henri Dunant[1] l’a rêvé, celui-là souffre profondément d’entendre combien souvent la convention de Genève[2] est repoussée. J’en ai appris assez par les honorables médecins allemands amis de la vérité.
C’est pourquoi je vous remercie sincèrement, Madame, d’avoir ainsi soigné affectueusement et accueilli nos chers blessés allemands.
J’ai préparé durant de longues années des femmes et des filles allemandes à la grande tâche des soins aux blessés en vue d’une guerre à venir. Le premier point de mon enseignement a toujours été de soigner également amis et ennemis. Je sais par expérience que mes anciennes élèves ont suivi mes conseils, que la semence est tombée en bon terrain.
Vous m’avez fait écrire en allemand ; Madame, si vous voulez répondre à ces lignes, cela ne me dérangera en aucune façon que ce soit en français, car je lis assez couramment le français.
Vous apprendrez sûrement et au mieux des nouvelles du lieutenant Félix Bertrand par le moyen du Comité central des sociétés allemandes de la Croix-Rouge, Berlin S.W. 11 Abgeordnetenhaus (« chambre des députés »).
Je vous remercie sincèrement de la conclusion de votre lettre et de ses termes si honorables pour moi ; ils honorent dans la même mesure la femme qui les a écrits et celui qui a fait siens les buts élevés de la Croix-Rouge.
Je vous assure, Madame, de ma haute considération, et vous prie de saluer vos enfants privés si jeunes de leur père. Je suis votre très dévoué,
Docteur Geissler
Médecin d’état-major et chirurgien,
lazaret de campagne n° 3, IIIe corps d’armée.
Témoignage de l’adjudant Walter, de la 1re batterie de 90, secteur postal 76, à Mme Leroy-Beaulieu
28 janvier 1915.
Madame,
Je reçois à l’instant votre lettre et m’empresse de vous faire part de tout ce que je peux savoir au sujet de la disparition de votre mari.
Je suis absolument confus des remerciements que vous m’adressez. Je n’ai en somme fait que mon devoir strict, et tout le monde à ma place vraiment en eut fait autant. Je regrette vivement de n’avoir pu recueillir d’indices précis permettant d’émettre une conclusion nette. Néanmoins, j’espère et je crois que votre mari doit être blessé et prisonnier. Voici d’ailleurs le récit des dernières phases de combat.
Lorsque nous fûmes débordés par l’infanterie ennemie et que nous reçûmes l’ordre de tenir jusqu’au bout, je me trouvais à la batterie avec votre mari. Il fit preuve du plus grand calme et du plus grand sang-froid, inspirant aux hommes une confiance absolue et le plus profond mépris du danger. Nous tirâmes notre dernière gargousse et lorsque l’ennemi fut à 200 mètres à peine de nos pièces, nous enlevâmes nos culasses et rendîmes nos pièces inutilisables. Il était environ 2 heures de l’après-midi.
À ce moment, le capitaine Leroy-Beaulieu me donna l’ordre de faire replier le personnel de la batterie sur Bucy, tandis que lui-même devait passer chez lui prendre ses affaires et retrouver son ordonnance, qui avait ordre de l’attendre avec ses deux chevaux sellés.
Nous descendîmes alors de la batterie en utilisant le plus possible les accidents de terrain pour nous abriter ; j’étais l’avant-dernier, votre mari était le dernier. Chacun de nous se dirigea vers son cantonnement respectif. Je n’ai plus revu mon capitaine.
Un de mes hommes m’a affirmé l’avoir vu remonter dans la direction de la batterie. Avait-il oublié quelque chose ? Sa jumelle ? Peut-être, ou voulait-il se rendre compte une dernière fois de la situation ?
J’espère bien qu’il nous le dira lui-même plus tard, car, je vous le répète, mon intime conviction est qu’il a dû être blessé et ensuite fait prisonnier. S’il avait été frappé mortellement, les Allemands, à mon avis, l’auraient laissé où il était tombé et les tirailleurs qui sont passés là l’auraient trouvé. Or, je les ai interrogés et ils n’ont rien vu dans la batterie, ni dans les environs.
De plus, ce qui peut également me donner quelque confiance, c’est que les Allemands qui nous étaient opposés se sont montrés très humains envers les blessés. Je tiens ce renseignement de fantassins français blessés qui n’ont pas été inquiétés et que leur médecin-major a pu ramener sous la protection de l’ennemi.
Lorsque je suis retourné, le soir, au combat, accompagné du maréchal des logis Cantinau, du brigadier Bladier et du canonnier Marcilleau, nous n’avons pas pu parvenir jusqu’à la batterie, qui était alors occupée par les Allemands. Nous n’avons pas trouvé trace de votre mari. Donc, tout me porte à croire qu’il a été blessé et emporté par des brancardiers allemands. Grâce à la parfaite connaissance qu’il avait de la langue de nos ennemis (nous nous sommes parfois entretenus en allemand et avons causé de Krenznach), il aura, je suppose, des facilités pour être soigné convenablement et on aura sans doute des égards spéciaux pour lui eu égard à sa personnalité bien connue.
C’est en tous cas avec une profonde émotion que j’ai dû évacuer Bucy avec mes hommes après avoir vainement attendu notre capitaine. Tous, nous regrettons un chef qui avait su se faire apprécier de tous, sa bravoure et sa connaissance parfaite des finesses de notre arme. Il était universellement regardé comme un officier de valeur et avait les meilleures relations avec ses camarades.
Pour ma part, je lui étais particulièrement attaché : d’abord, il était « mon capitaine », titre qui signifie bien des choses en temps de guerre ; de plus, je ne sais si vous le saviez, mon père fut le professeur de votre mari à l’École d’application de Fontainebleau ; nos rapports, par suite, furent empreints, dès le premier moment, de la plus grande cordialité.
Je vais m’occuper de vous faire parvenir les cantines, et les différentes affaires appartenant à votre mari. Mais pour cela, je dois m’adresser au commandant de Brosse, car il doit y avoir quelques formalités à remplir. Sa culotte lui était bien parvenue, ainsi que l’iode. À ce propos, la batterie ne dispose que d’une très petite quantité de ce médicament, ainsi que de sérum antitétanique ; s’il vous était loisible de nous en procurer, nous vous en serions très reconnaissants.
Son ordonnance est César Salmon. Il est marié, a perdu au mois de juin dernier un garçon de 9 ans. Sa femme demeure à Saint-Dié, 5 rue des Jointures. C’est un très brave homme, que j’avais recommandé et présenté moi-même à votre mari.
Voici, Madame, tout ce que je puis savoir. J’ai donné votre adresse à l’ordonnance Salmon, qui vous écrira lui-même, ainsi que vous en avez manifesté le désir.
Son ordonnance m’a remis une somme de 300 francs en or (15 louis) que je vous ferai parvenir après avoir rendu compte au commandant de Brosse.
Veuillez croire, Madame, que je prends une grande part à votre chagrin et à l’angoisse que vous éprouvez, car ma famille a été durement éprouvée pendant cette campagne. Je compte 21 tués, blessés ou disparus depuis le commencement des hostilités.
Veuillez agréer, Madame, mes hommages très respectueux.
Léon Walter.
Un souvenir d’enfance et de fidélité patriotique
Pierre Gourmain, notre conseiller général dans les années 1950[3], évoquait en quelques lignes dans le bulletin d’informations de la Légion d’honneur, le capitaine Leroy-Beaulieu.
Dans les premiers jours de septembre 1914, un jeune garçon de 7 ans, plongé dans la guerre, voit passer les troupes françaises rescapées de la défaite de Charleroi, qui avait été suivie, on l’ignore souvent, d’une vigoureuse contre-attaque, menée par le général Lanzerac, dans la région entre Guise et Saint-Quentin, les 29 et 30 août.
Elles sont poursuivies par les troupes allemandes, des petits combats retardateurs sont héroïquement livrés aux ponts de passage de la rivière Aisne, mais les Allemands courent vers la Marne. Une importante formation de « hussards de la mort » traverse fièrement le petit bourg de notre gamin.
Mais les 12 et 13 septembre, von Klück, battu sur la Marne, retraite en désordre. Les mêmes uhlans repassent dans le bourg, fatigués, débandés… Les troupes anglaises de Douglas Haig les poursuivent, souvent de très près, et s’arrêtent au bord sud du plateau du Chemin des Dames. Cette situation dure jusqu’au début novembre, après la relève des Anglais par les Français de Maunoury.
Après trois jours de bombardement, les Allemands attaquent et reprennent la ville.
Ils en évacuent les habitants restants à Anizy-le-Château ; notre gamin fait la route, 15 kilomètres, de nuit, tantôt à pied, tantôt juché sur un cheval !
Un jour de janvier 1915, il a 7 ans et demi, sa mère l’emmène assister, à la chapelle du château d’Anizy, propriété de la famille d’Aramon, aux obsèques d’un capitaine d’artillerie, décédé de ses blessures, après avoir été capturé par les Allemands. Il s’agissait du capitaine Pierre Leroy-Beaulieu, du 9e d’artillerie.
Les Allemands, après un service religieux, lui rendirent les honneurs militaires et un officier prononça, en français, une émouvante allocution. Notre petit garçon en fut très impressionné et, malgré son jeune âge, se souvient toujours du nom du capitaine.
Soixante-dix ans plus tard, le 16 janvier 1985, un journal local publie un avis de messe célébrée à la mémoire de membres de la famille Leroy-Beaulieu ! Notre petit garçon est âgé maintenant de 78 ans, mais il se souvient toujours. Il écrit au journal, lui demande l’adresse ou, à défaut, de transmettre sa lettre, mais ne reçoit aucune réponse.
Certains hommes sont têtus ; les faits aussi, paraît-il ? En août 1988 ont lieu les « Jeux Intervilles » à la télé, les maires des villes y assistent, l’un d’eux, maire d’Agde, est nommé : M. Leroy-Beaulieu. Déclic chez notre septuagénaire, devenu entre-temps capitaine de réserve, ancien prisonnier, maire, conseiller général et vice-président de cette assemblée, chevalier de la Légion d’honneur, qui écrit au maire d’Agde !
Pierre Gourmain poursuit :
Ainsi qu’il ressort de l’encadré ci-contre [l’auteur rappelle dans son mémoire les légionnaires de la famille], trois de ses fils et l’un de ses petits-fils ont été admis dans l’ordre de la Légion d’honneur, parmi lesquels son dernier fils, Marc, lieutenant au 3e régiment d’automitrailleuses de cavalerie, tombe au champ d’honneur le 16 mai 1940 à Dizy-le-Gros (Aisne), célèbre bataille de Montcornet avec De Gaulle.
Polytechnicien, homme d’une rare érudition, Pierre Leroy-Beaulieu laissa une œuvre d’une portée considérable, auquel rendit hommage en 1924 L’Anthologie des écrivains morts à la guerre de 1914-1918, publiée par l’Association des écrivains combattants[4].
Quelle leçon tirer de cette belle histoire ? D’abord que le souvenir peut être impérissable, quand le genre d’éducation favorise la fidélité à un souvenir particulièrement émouvant et le respect de solides vertus humaines, dont le patriotisme n’est pas la moindre.
[1] Jean Henri Dunant, l’homme de la bataille de Solférino en 1859, est né à Genève en 1828. Il comprend lors de cette bataille le besoin de venir en aide et de soigner les militaires blessés. Il est le père fondateur de cet organisme international et reçoit en 1901 le prix Nobel de la paix. En 1859, il avait pris la nationalité française. Il est mort à Heiden (Suisse) en 1910.
[2] Première convention de Genève, 1864.
[3] Pierre Gourmain (Vailly-sur-Aisne, 7 juin 1907 – Reims, 31 mars 1992), maire de sa ville natale de 1971 à 1977, a été conseiller général du canton de Vailly-sur-Aisne pendant trente ans de 1949 — il succède à Hervé Delcelier — à 1979, où il connaît la défaveur du scrutin, battu par Raymond Sudolski. Il était capitaine de réserve, prisonnier durant la guerre de 1940, chevalier de la Légion d’honneur, membre de la 6e commission au conseil général (bâtiments départementaux et reconstruction).
[4] L’Anthologie des écrivains morts à la guerre (1914-1918), Bibliothèque du Hérisson, Edgar Malfère, Amiens, 1924. Cette anthologie a été publiée sous le patronage de M. le Président de la République, de M. le président du Conseil des ministres et de MM. les membres du gouvernement, de la Société des gens de lettres, de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique de France. L’hommage pour Pierre Leroy-Beaulieu : tome Ier, p. 409 à 413, par Pierre Masson.